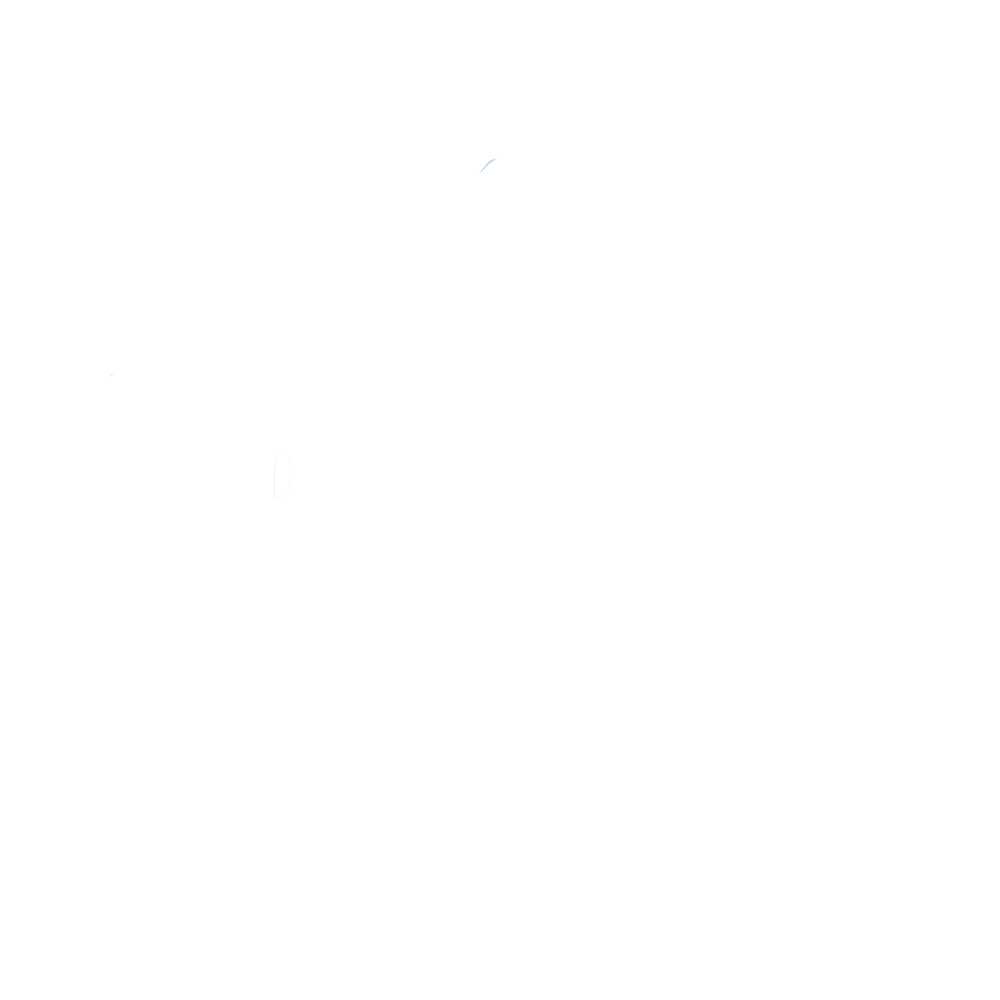
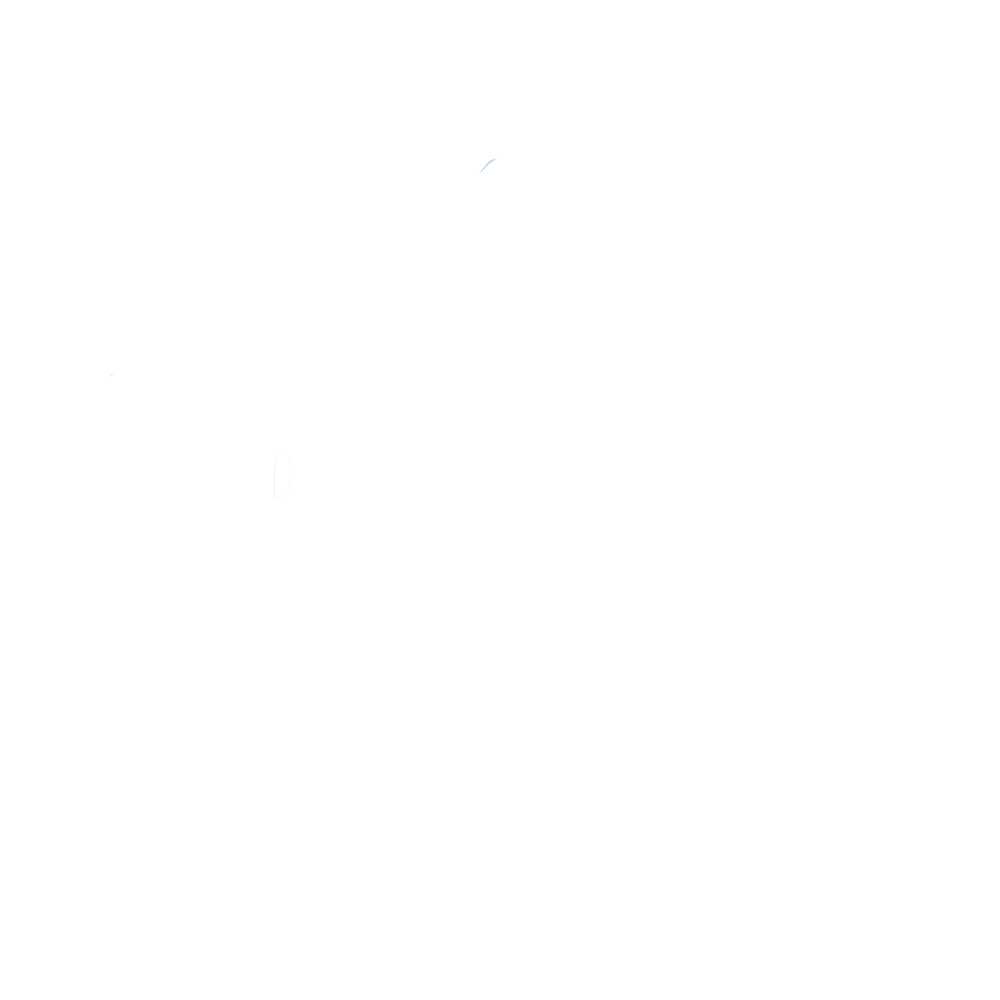
La Loi sur les accidents du travail institue le principe de la responsabilité sans faute de l’employeur, fondée sur le risque professionnel et limitant cette responsabilité qui est forfaitaire.
L’extension se fera par étapes à différentes professions pour se terminer en 1923 par la loi du 2 août 1923 relative aux gens de maison.
Pour en savoir plus, visiter : Le Musée national de l'Assurance Maladie
Loi relative à l’assistance aux vieillards infirmes et incurables : amalgame de tous les handicaps, une seule assistance est prévue, la prise en charge de l’hébergement.
Loi de création des pensions aux mutilés et victimes de la guerre, des centres d’appareillage, des centres de rééducation fonctionnelle et des emplois réservés.
Début de l’histoire de l’emploi des personnes handicapées
Trois notions de cette loi se retrouveront dans les textes qui suivront :
- Obligation aux entreprises de plus de 10 salariés d’employer des pensionnés de guerre, et veuves de guerre, (quota d’emploi de 10%).
- Pourcentage obligatoire des emplois réservés,
- Salaire avec éventuel abattement.
Mai 1924
C’est aussi le droit à la rééducation professionnelle.
La loi prévoit que les centres de rééducation soient ouverts aux victimes d’accident du travail.
Extension de la loi du 26 Avril 1924 aux mutilés du travail
Prise de conscience sociale collective.
Loi sur les assurances sociales – tous salariés concernés – aide à la famille – maternité – décès.
L’assurance sociale se transforme en Sécurité Sociale.
Regroupement des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales.
Développement de la rééducation fonctionnelle et professionnelle (C.R.F. et C.R.P.).
Assistance à certaines catégories d’aveugles et de grands infirmes.
Délivrance de la carte d’invalidité.
La question du travail des handicapés est abordée dans les débats politiques.
Ouverture des services publics de réadaptation fonctionnelle.
La notion d’aide aux handicapés s’élargit.
Création des CAT (Centre d’Aide par le Travail).
Loi sur le reclassement des travailleurs handicapés :
Définition du travailleur handicapé
Principes généraux de la réinsertion professionnelle (réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle)
Priorité d’emploi
Création des Ateliers protégés (AP) pour l’emploi des TH.
Le mot handicapé entre dans le langage politique en tant que travailleur.
Les handicapés mentaux sont compris dans le reclassement des travailleurs handicapés.
Cette loi marque une véritable avancée dans l’insertion des handicapés en élargissant tout d’abord la notion de Travailleurs handicapés à toute personne handicapée autre que les mutilés de guerre, accidentés du travail et infirmes.
Création des Commissions Départementales d’Orientation des Infirmes (CDOI)
Une obligation d’emploi de 3% de personnes handicapées reconnues par la CDOI est incluse dans les 10% qui étaient jusqu’alors prévus uniquement pour les mutilés de guerre, accidentés du travail et les infirmes. Elle concerne les entreprises à partir de 10 salariés.
Cette loi organise le travail protégé.
AP et CAT confèrent un caractère thérapeutique à leur emploi mais les textes restent flous sur le % obligatoire d’embauche
La 101 n068-5 du 3 Janvier 1968 : traitant des mesures de protection judiciaires applicables aux personnes majeures qui, à raison notamment de leur handicap, nécessitent que soit prononcée à leur égard une mesure de protection ou d'accompagnement spécifique, du type sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle
Financement des aménagements de postes par l’État
Création de l'AAH
La Loi d’orientation en faveur des personnes handicapées intègre l’ensemble des dispositions antérieures. L’insertion des personnes handicapées est une obligation nationale.
La loi de 1975 qui a permis d’affirmer et de garantir les droits fondamentaux des handicapés, a surtout encouragé le développement du secteur protégé tout en permettant une meilleure interpénétration avec le milieu ordinaire (notamment avec la possibilité de conclure des contrats de sous-traitance entrant dans l’obligation d’emploi des entreprises).
Création des COTOREP (Commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel) qui succèdent aux CDOI.
La loi institue une garantie de ressources à tout handicapé exerçant une activité professionnelle.
Approche différente du problème, on passe du système d’assistance à celui d’une solidarité nationale en l’abordant sous son triple aspect : technique, humain et économique.
Décret relatif aux Équipes de Préparation et de Suite au Reclassement (EPSR)
8 Décembre 1978
Circulaire 60 AS du 8 décembre 1978 relative aux centres d’aide par le travail.
Création des Groupements Interprofessionnels Régionaux pour la Promotion de l’Emploi des Personnes Handicapées (GIRPEH).
Loi N°81-3 relative à la protection de l’emploi des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Suspension du contrat de travail pendant la durée de l’arrêt de travail et du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation accordé sur décision de la COTOREP.
Limitation du droit de l’employeur au licenciement (motif lié à l’invalidité).
Obligation pour le l’employeur de proposer un nouveau poste au salarié de venu inapte.
Création et développement des Organismes d’Insertion et de Placement (OIP).
Loi n° 087-517 au profit des travailleurs handicapés reconnus par la COTOREP, des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une Incapacité permanente au moins égale à 10 %.
Cette loi a eu pour objectif de privilégier l’insertion en milieu ordinaire.
L’obligation d’emploi issue de la loi de 1957 se révélait alors complexe et mal appliquée.
Le taux d’emploi légal a été modifié pour atteindre, à compter de 1991, 6% pour les entreprises de 20 salariés et plus.
D’autres modalités leur permettent de s’acquitter de leur obligation :
Sous-traitance avec le secteur protégé,
Accord d’entreprise,
Versement d’une contribution libératoire, pour chaque emploi non pourvu, à un fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH).
L’obligation d’emploi est étendue au secteur public.
L'article 22 dispose que les jeunes adultes handicapés peuvent être maintenus dans les établissements d'éducation spéciale au-delà de l'âge réglementaire, faute de places dans les établissements pour adultes (amendement Creton).
Loi n° 090-602 relative à la protection des personnes contre la discrimination en raison de leur état de santé ou de leur handicap.
Lancement des programmes partenariaux de l’ AGEFIPH
Loi n° 91-663 portant diverses mesures destinées à favoriser l' accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public.
Transfert par l’État du financement des aménagements de postes et des surcoûts d’encadrement à l’AGEFIPH.
Lancement des Programmes Départementaux pilotes de l’ÉTAT (futurs PDITH)
31 décembre 1992
La loi étend l’obligation de rechercher une possibilité de reclassement à tout salarié devenu physiquement inapte.
Lancement des Schémas régionaux de la formation professionnelle de l’AGEFIPH
4 novembre 1993
Décrets no 96 -121 et 93 1217 du 4 novembre 1993 relatifs au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités.
Convention ÉTAT/AGEFIPH relative aux EPSR / OIP
18 janvier 1994
Loi n° 94-43 : l'article 58 concerne le complément d' Allocation pour Adultes Handicapés (AAH).
26 janvier 1994
Décret n° 94-86 : Accessibilité des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public.
Circulaire n° 96-428 : Prise en charge et réinsertion sociale et professionnelle des traumatisés crâniens.
31 décembre 1996
Loi de finances pour 1997.
Transfert du complément de rémunération versé dans le cadre de la Garantie de ressources en milieu ordinaire (GRTH) de l’État à l’AGEFIPH.
Arrêté : Prescription techniques pour l'accessibilité de la voirie
Publication du Décret 2003-1220 ( 19/12/2003) sur la réforme des COTOREP.
La loi n° 2004-1486 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a été publiée le 30 décembre 2004 .
Elle réprime pénalement la diffamation, l'injure, la provocation à la discrimination, la haine ou la violence sexiste, handiphobe ou homophobe en les alignant sur les peines prévues en matière de propos racistes.
Ainsi, l'Article 21 de la Loi précise :
« Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. » ;
« Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. »
La Loi 2005-102, 2005-02-11 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées"
Définit pour la 1ère fois en France le terme handicap :
"Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant".